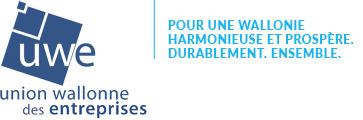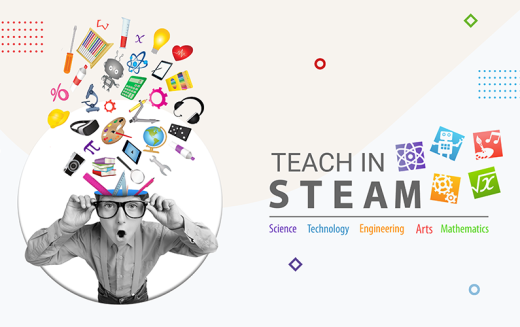Actualités
Placez vos collaborateurs au cœur de la transformation digitale de votre entreprise !
[ PUBLIRÉDACTIONNEL ] La transformation digitale de votre entreprise représente un défi de taille. Nombreux sont ceux qui pensent d’emblée à la digitalisation des processus commerciaux difficiles tels que la
Lire la suite« Convergences » : plus de 800 inscrits !
L’Union Wallonne des Entreprises et les 5 Chambres de Commerce et d’Industrie vous convient, le 23 avril prochain, à une soirée exceptionnelle et inédite. Nos 6 entités s’unissent pour dessiner
Lire la suiteUn facilitateur permet d’augmenter significativement les chances de réintégration après un burn-out
[ PUBLIRÉDACTIONNEL ] « Les chiffres du burn-out ne cessent d’augmenter. La moitié des personnes craignent une rechute après un burn-out et c’est le cas pour à peu près un quart
Lire la suiteDécouvrez l’écosystème de l’économie circulaire en Wallonie !
Découvrez les projets et acteurs innovants, les dispositifs de soutien, publications et événements clés autour de l’économie circulaire en Wallonie. La plateforme numérique « Ecosystème Circulaire », lancée par la
Lire la suiteTeachInSTEAM : une approche novatrice pour sensibiliser aux STEAM et au numérique !
Le projet TeachInSTEAM, financé par le Plan de Relance de la Wallonie, souhaite agir sur les représentations des métiers techniques, technologiques et numériques. Porté par le SeGEC et ses partenaires,
Lire la suiteDynam!sme #296 : le numéro de printemps de l’E-MAGAZINE de l’UWE est paru !
Le dernier numéro de « Dynam!sme », au format 100% numérique, et multimédia, vient de paraître ! Au sommaire de ce numéro de printemps : les priorités de l’Union Wallonne
Lire la suiteCoupe du Monde de l’Entrepreneuriat : l’UWE et le VOKA sélectionnent nos champions !
L’UWE organisait ce lundi 18 mars avec son homologue flamand VOKA une étape de sélection de la « Coupe du Monde de l’Entrepreneuriat ». Les trois lauréats sélectionnés participeront à la grande
Lire la suiteJUUNOO remporte les Circular Business Awards !
Ce 14 mars, la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) a remis, lors d’une cérémonie de clôture officielle, les Circular Business Awards (CBA). Ces récompenses sont l’occasion de mettre en
Lire la suiteBaromètre SDGs 2024 : l’enquête est ouverte !
Pour rappel, c’est le 1er janvier 2016 que les 17 objectifs de Développement Durable (ODD ou SDGs en anglais) de l’Agenda 2030 ont été officiellement lancés. Cet agenda a été approuvé
Lire la suiteLe Federal Learning Account est irréalisable : les employeurs tirent la sonnette d’alarme
La loi relative au Federal Learning Account (FLA) entrera en vigueur le 1er avril prochain. Il s’agit d’un outil dans lequel toutes les formations proposées à chaque travailleur de toutes
Lire la suite